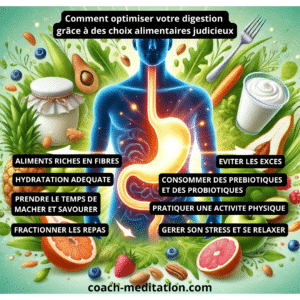INJONCTION MORALE
L’ouvrage part d’un constat quelque peu commun: notre société a érigé la santé au rang de valeur primordiale. Il vaudrait mieux arrêter de fumer, diminuer sa consommation d’alcool, manger cinq fruits et légumes par jour, éviter les graisses et cuisiner des aliments sains riches en vitamines. Il faut aussi faire du sport, car c’est bon pour la forme, pour l’équilibre et contre le stress. L’image d’une personne saine et mince qui fait son jogging tous les matins est érigée en modèle, et tous ceux qui n’atteindraient pas cet idéal, notamment les obèses, sont soupçonnés de manquer d’hygiène, d’être paresseux, voire incapables de se prendre en main.
Si, en soi, être en forme et bien dans son corps est un objectif louable, les deux auteurs montrent que la tendance a dégénéré en une forme d’injonction morale dont il devient très difficile de se libérer. Aux Etats-Unis, une douzaine d’universités font désormais signer à leurs étudiants des «contrats de bien-être», dans lesquels ils s’engagent à avoir une hygiène de vie impeccable. Rassurant pour leurs parents, sans aucun doute. Mais dommage pour ces jeunes gens muselés, car ce sont bien les erreurs qui forment la jeunesse, rappelle Carl Cederström. Jean-Paul Sartre aurait-il pensé l’existentialisme en sirotant du thé vert et des biscuits bios?
MERCI PATRON
Ces anecdotes peuvent prêter à sourire. Les deux chercheurs grossissent d’ailleurs le trait en listant le marché très lucratif du bien-être – et souvent «bidon». Il y a ces directeurs des ressources humaines qui se renomment «directeurs du bonheur». Il y a ces coachs de vie qui aident leurs clients à mieux se connaître en caressant des chevaux. Il y a cette consultante star, Martha Beck, auteure du programme «Escape from the man cage», qui lâche les cadres déprimés dans le désert ou la jungle… Mais apprendre à faire un feu ou traquer les bêtes sauvages a un coût non négligeable, qui s’élève parfois à près de 10 000 dollars !
Le monde de l’entreprise est particulièrement touché par cette mode. Tout en poussant les salariés à travailler le plus possible, dans des conditions de plus en plus précaires, les firmes leur proposent des séances de méditation en pleine conscience afin de se détendre, ou leur installent des tapis de course au bureau, pour pianoter sur l’écran tout en perdant des calories. Cette tendance gagne depuis plusieurs années les bords du Léman, où les multinationales encouragent leurs salariés à manger des légumes et pratiquer régulièrement du sport.
Une hypocrisie totale, expliquent Carl Cederström et André Spicer, qui n’hésitent pas à en référer à Orwell pour décrire ce monde où l’homme doit être le plus performant possible, tout en gardant le sourire. Pour une raison simple: «Un travailleur heureux est un travailleur plus productif»! En Angleterre, l’entreprise suédoise de poids lourds Scania surveille les constantes vitales de ses employés 24h/24. Ceux-ci sont pénalisés s’ils ne font pas assez d’exercice et si leur système cardiovasculaire est un peu à la traîne. Il y a quelques jours, la société d’assurance américaine Aetna annonçait fièrement offrir des bracelets connectés Fitbit à ses salariés. «S’ils prouvent qu’ils enchaînent 20 nuits de 7 heures de sommeil ou plus, nous leur offrirons 25 dollars par nuit, plafonnés à 500 dollars par an», a déclaré son PDG Mark Bertolini.
Loin d’être un livre léger, Le Syndrome du bien-être dresse au fil des pages un constat glaçant. Mis sous pression, l’individu se sent coupable s’il ne parvient pas à dompter son corps. Pour les deux chercheurs, le culte de la santé tient de l’ultralibéralisme: l’homme est seul responsable de son état – sous-entendu de ses performances. S’il échoue à mincir, à courir, à se muscler et à faire du yoga, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même.
Faire croire aux chômeurs qu’ils peuvent trouver du travail en mincissant, en faisant un joli CV et en suivant des formations contre le stress est un mensonge.
Une idéologie très dangereuse, insiste Carl Cederström au téléphone. «Car dire cela, c’est oublier que la santé est avant tout une affaire publique et politique, explique le chercheur. Toutes les études montrent que les classes défavorisées ont moins la possibilité de manger sainement. En stigmatisant les obèses, l’Etat ne joue pas son rôle. De même, faire croire aux chômeurs qu’ils peuvent trouver du travail en mincissant, en faisant un joli CV et en suivant des formations contre le stress est un mensonge. La vérité, c’est que l’industrie du bien-être est encore un domaine réservé aux riches.» Et de qualifier de «stupide» le projet du républicain Paul Ryan, aux Etats-Unis, qui proposait aux pauvres d’engager des coachs de vie en contrepartie des aides sociales.
SURVEILLER ET PUNIR
A l’échelle de l’histoire, cette évolution est récente. Dans la Grèce antique et pendant le Moyen Age, le bonheur est lié à la vertu, car il ne dépend pas de l’homme mais des dieux. Les philosophes des Lumières marquent un changement d’ère, en relevant pour la première fois que le bien-être est avant tout un accomplissement personnel. Le mouvement s’accentue dans les années 1960, au moment où la psychologie érige le bonheur au rang de valeur ultime. «Quitte à dompter son corps pour y parvenir, comme on nous le fait croire depuis une dizaine d’années», ajoute Carl Cederström.
Très érudit, l’ouvrage qu’il a coécrit avec André Spicer regorge de références savoureuses au cinéma (Matrix), à la littérature (Aldous Huxley) ou à la philosophie (Deleuze sur les «sociétés de contrôle»). Le passage sur le lifelogging (enregistrement de la vie en continu, au moyen d’applications notamment) fait particulièrement froid dans le dos. Le fonds d’investissement américain GLG Partners a mis en place un programme qui analyse les heures de sommeil ou l’alimentation de ses traders. Le syndicat des enseignants de Chicago soumet ses membres à un suivi personnalisé les contraignant à surveiller leur cholestérol et à pratiquer une activité sportive, sous peine de quoi ils doivent payer une amende de 600 dollars… S’ils n’étaient pas réels, ces exemples pourraient bien passer pour de la science-fiction. Les auteurs sont implacables: «Surveiller sa vie comme s’il s’agissait d’une véritable entreprise correspond en tout point de vue à la mentalité de l’agent idéal du néolibéralisme.»
Les deux chercheurs ne sont pas les premiers à dresser ce constat. Ils énoncent ouvertement leurs sources d’inspiration, notamment le travail d’Alenka Zupancic sur la «biomoralité». Mais le livre, sarcastique et instructif, offre un grand bol d’air d’anticonformisme. Carl Cederström voit-il une solution à la dérive du bien-être? «Il faut juste que ça s’arrête, conclut-il. Si vous voyez un coach dans votre entreprise vanter les effets de la psychologie positive, dites-lui que c’est du n’importe quoi.» La «quête paranoïaque du bonheur» est une fausse piste. Et puis comme ils l’écrivent en conclusion, «vivre, c’est nécessairement faire l’expérience de la douleur et de l’échec, accepter que certaines choses peuvent nous faire défaut et, dans une certaine mesure, apprendre à faire contre mauvaise fortune bon cœur».
A lire
Carl Cederström et André Spicer, «Le Syndrome du bien-être», traduit de l’anglais par Edouard Jacquemoud, Ed. L’échappée, 176 p.